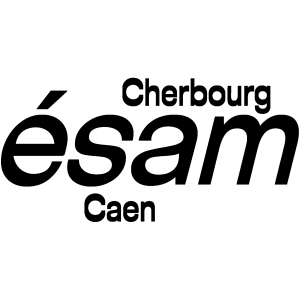[CDC M1-ART-25-26] Initiation à la recherche
Section outline
-
________________________ FICHE DE COURS – 2025-2026______________________
Nom et prénom de l’enseignant·e : Alice LAGUARDA
Titre du cours : Esthétique
Sous-titre du cours : Arts et utopies.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Prérequis pour les étudiant·es :
- Capacité à construire un questionnement personnel
- Maîtrise de connaissances théoriques et des acquis de culture générale
Contenu détaillé du cours : À partir d’un panorama critique de l’histoire des utopies littéraires et philosophiques, nous nous intéresserons aux construction imaginaires portées par les utopies dans leurs dimensions sociales, esthétiques et politiques. Nous étudierons les effets de l’imaginaire utopique dans l’art et l’architecture, des années 1960 à la période contemporaine, en ce qui concerne la relation du corps à l’espace, de l’individu au groupe, ainsi que dans les liens à la science-fiction. Nous observerons comment ces productions illustrent la tension entre utopie et dystopie, revisitent et questionnent l’histoire de l’architecture moderne et l’histoire coloniale, convoquent les notions d’écart, de fiction, ou encore de « micro-utopies ».
Références bibliographiques et/ou webographiques :
Voyages aux pays de nulle part, Robert Laffont, Paris, 1990
Chantal Béret, Utopies urbaines, nouvelles de nulle part, RMN, Valence, 2001
Utopie, la quête de la société idéale en Occident, BNF/Fayard, Paris, 2001
Dominique Rouillard, Superarchitecture. Le futur de l’architecture 1950-70, éd. de La Villette, Paris, 2004 Sergio Vega, El paraiso en el nuevo mundo, Palais de Tokyo, Paris, 2006
Jordi Colomer, Fuegogratis, Le Point du jour, Cherbourg/Musée du Jeu de Paume, Paris, 2008
Catalogue de l’exposition Insiders, CAPC, Bordeaux/Les Presses du réel, Dijon, 2010
Architectures expérimentales 1950-2012, HYX/Frac Centre, Orléans, 2013
Utopia/Dystopia, Catalogue de l’exposition au MAAT, Lisbonne, Les Presses du réel, Dijon, 2017
Françoise Sylvos (dir.), Utopies et dystopies coloniales, Actes du colloque à Saint-Denis de la Réunion, éditions K’A, 2019
Obed Frausto, Sébastien Lefèvre et Angelica Montes (dir.), Utopies et dystopies dans l’imaginaire politique, L’Harmattan, Paris, 2022.
Tabita Rezaire, conscience u.terre.ine, Les Presses du réel, Dijon, 2022
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Méthode d’enseignement : Cours magistraux.
Objectifs du cours : Utiliser l’étude de problématiques philosophiques dans l’histoire des arts et des idées pour que l’étudiant.e puisse se situer, s’engager artistiquement et philosophiquement dans le monde
Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours :
· Acquisition de connaissances :
· Histoire des idées (littérature et philosophie, XIXe-XXIe siècles)
· Histoire des arts (XXe et XXIe siècles, art et architecture)
· Utiliser l’étude de problématiques philosophiques dans l’histoire des arts et des idées pour que l’étudiant.e puisse se situer, s’engager artistiquement et philosophiquement dans le monde
Modalités et critères d’évaluation :
Contrôle continu + contrôle terminal (devoir écrit)
Critères d’évaluation du devoir écrit :
· Maîtrise de l'expression écrite : organisation et pertinence des idées, qualité de l'argumentation
· Consolidation des connaissances théoriques et des acquis de culture générale permettant d'élargir la recherche personnelle ainsi que le regard critique de l'étudiant
· Lectures, recherches en bibliothèque, appui sur les documents d’étude accompagnant les cours (bibliographie, filmographie)
Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiant·es : NR.
-
1. Le tournant narratif de l’art contemporain avec L. BUFFET
________________________ FICHE DE COURS – 2025-2026______________________
Nom et prénom de l’enseignant·e : Laurent BUFFET
Titre du cours : Art et littérature
Sous-titre du cours : Le tournant narratif de l’art contemporain
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Prérequis pour les étudiant·es : Semestre 6.
Contenu détaillé du cours : Tenu à distance par un modernisme qui entendait affirmer son autonomie vis-à-vis de la littérature, le récit réapparaît, dans l’art contemporain, sous des formes très variées : comme cadre interprétatif nécessaire à la compréhensions d’une œuvre (l’aventure Tatare de Joseph Beuys), comme instance documentaire relatant le déroulement d’une action (les nombreux films, photographies et textes de l’art dit « processuel »), comme élément pseudo-documentaire intégré à une installation (Ilya Kabakov), en tant que mode d’existence de l’œuvre (le Narrative art et ses dérivés), etc. À considérer le rôle prédominant que le langage revêt dans se tournant narratif de l’art, sans doute n’est-il pas exagéré de dire que l’époque contemporain renoue, par delà le Laocoon de Lessing qui en avait marqué l’abandon, avec la vulgate dominante à l’époque de la Renaissance, inspirée de la célèbre phrase d’Horace : Ut pictura poesis (« la poésie est comme la peinture »). Nous consacrons ce cours à l’étude des différentes modalités de l’« intelligence narrative » (Ricœur) dans l’art contemporain.
Références bibliographiques et/ou webographiques :
Leon Battista Alberti, De pictura, Paris, Allia, 2010
Roland Barthes, « Introduction à l’analyse structurale des récits », in Poétique du récit, Paris, Seuil, 1977
Gérard, Genette, Discours du récit, Paris, Seuil, 2007
Gérard Genette, Fiction et diction, Paris, Seuil, 2004
Philostrate, La Galerie de Tableaux, Paris, Les Belles Lettres, 1991
Pline l’Ancien, Histoire Naturelle XXXV : La Peinture, Paris, Les Belles Lettres, 2002
Jean-Marc Poinsot, Quand l’œuvre a lieu : l’art exposé et ses récits autorisés, Genève, Mamco/Les presses du réel, 2008
Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1996
Paul Ricœur, Temps et récit 1. L’intrigue et le récit historique, Paris, Seuil, 1991.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Méthode d’enseignement : Cours magistraux durant lesquels nous confrontons la théorie de l’art à la réalité des œuvres, au moyen de projections et de l’analyse d’écrits d’artistes.
Objectifs du cours : Acquis de connaissances sur l’histoire et la théorie de l’art ; capacité, pour l’étudiant, de situer sa propre démarche plastique par rapport aux grandes problématiques de l’art contemporain ; approfondissement de la pratique rédactionnelle.
Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours : NR.
Modalités et critères d’évaluation : Devoir à la maison.
Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiant·es : NR.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2. Langue, littérature et nation avec E. ZWENGER
________________________ FICHE DE COURS – 2025-2026______________________
Nom et prénom de l’enseignant·e : Emmanuel ZWENGER
Titre du cours : Art et littérature
Sous-titre du cours : Langue, littérature et nation
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Prérequis pour les étudiant·es : Semestre 6.
Contenu détaillé du cours : La notion de littérature repose sur l’émergence simultanée d’une langue vernaculaire et d’une nation grâce à laquelle il est possible de décrire une histoire géopolitique de la littérature.
Références bibliographiques et/ou webographiques :
Pascale Casanova, La République mondiale des lettres, Paris, Seuil (Points Essais), 1999.
Denis Hollier, De la littérature française, Paris, Bordas, 1993.
Bernard Cerquiglini, Une langue orpheline, Paris, Minuit, 2007.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Méthode d’enseignement : Cours
Objectifs du cours : Établir une histoire de la littérature sous l’angle géopolitique.
Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours : Histoire de la littérature dans ses rapports à la langue.
Modalités et critères d’évaluation : Assiduité et participation ; rendu écrit en fin de semestre 1.
Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiant·es : Fin de semestre.
-
Vous trouverez les fiches de cours des séminaires d'initiation à la recherche en téléchargeant le document ci-dessous.
-
________________________ FICHE DE COURS – 2025-2026______________________
Nom et prénom de l’enseignant·e : Benjamin HOCHART
Titre du cours : Méthodologie et suivi de mémoire
Sous-titre du cours : NR.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Prérequis pour les étudiant·es : NR.
Contenu détaillé du cours : La formation à la recherche est présente tout au long du cursus dans les écoles supérieures d’art. Elle prend forme, notamment, dans les séminaires d’initiation à la recherche, plates-formes de recherche réunissant enseignant·es, artistes, théoricien·nes et étudiant·es autour d’objets de recherche et de thématiques pluridisciplinaires. En second cycle, il s'agit d'une initiation qui intervient en complément du travail plastique par la rédaction et la soutenance d’un mémoire. Ce dernier est un outil de réflexion qui permet à l'étudiant·e de construire son projet de diplôme et de prendre de la distance théorique par rapport au travail plastique.
Références bibliographiques et/ou webographiques : Diverses et nombreuses : écrits théoriques, journaux, livres d’artistes, entretiens, bande-dessinées…
Mémoires de diplômé·es de l’ésam, mémoires de diplômé·es d’autres écoles.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Méthode d’enseignement :
Cours magistraux de méthodologie et suivi de mémoire :
· Présentation et préparation aux attendus du mémoire de master en école supérieur d’art.
· Présentation d’exemples de mémoires, de ressources documentaires.
· Apports méthodologiques à partir de diverses méthodes et typologies d’écriture.
· Apports méthodologiques pour initier l’écriture et la rendre régulière.
· Apports méthodologiques pour comprendre les enjeux d’une bibliographie et en constituer une pertinente au regard du travail plastique et du mémoire.
· Rencontres et échanges avec des diplômé·es de l’ésam à propos de leur mémoire de DNSEP.
· Réflexion et ressources à propos des formes du mémoire.
· Réflexion et ressources pour situer son mémoire et se situer artistiquement.
· Accompagnement dans le lien de tutorat.
· Accompagnement dans l’avancement et la finalisation du mémoire.
· Échanges questions-réponses.
· Co-construction de la recherche et des choix d’objets d’études.
· Apports méthodologiques et suivis sur 3 semestres.
Objectifs du cours :
· Accompagner sereinement à découvrir les enjeux du mémoire et ses attendus.
· Réussir à élaborer un projet de mémoire pertinent au regard des intérêts de l’étudiant·e.
· Accompagner l’écriture, la réalisation et la soutenance du mémoire.
· Accompagner la relation tuteur·ice/étudiant·e pour un suivi serein et efficace.
Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours :
· Méthodes de recherche, méthodes d’écriture.
· Inscription dans le champ artistique contemporain et ses débats (se situer).
· Élaboration d’une écriture en lien au travail plastique.
Modalités et critères d’évaluation : Contrôle continu, Assiduité aux cours, engagement dans la recherche et l’écriture du mémoire.
Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiant·es : 16 octobre pour produire un document permettant de définir un projet de mémoire et un choix de tutorat