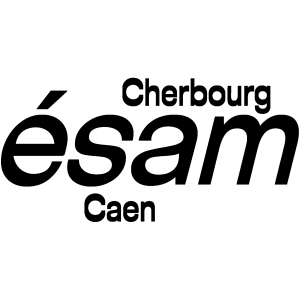[CDC-DNA3-ART-25-26] Méthodologie, techniques et mises en œuvre
Résumé de section
-
Vous trouverez l'ensemble des fiches de cours des Workshops de rentrée en téléchargeant le document ci-dessous.
-
1. ARCHIVIDEO
________________________ FICHE DE COURS – 2025-2026______________________
Nom et prénom de l’enseignant·e : CARGIOLI Simonetta
Titre du cours : Archividéo.
Sous-titre du cours : Comment faire archive à partir du fonds Vidéo Art Plastique
______________________________________________________________________________________________________________________________Nom de la ou du technicien associé : Camilo BAYTER
______________________________________________________________________________________________________________________________
Prérequis pour les étudiant·es : Aucun
Contenu détaillé du cours : En 2014, suite à la dissolution administrative et à la fermeture du Wharf, centre d’art contemporain de Basse-Normandie, à Hérouville-Saint-Clair, le fonds du festival Vidéo art plastique a été légué à notre école.
Ce festival a été créé en 1986 pour concevoir et mettre en œuvre des rencontres autour de la vidéo électronique analogique, ce un vaste continent appelé, depuis les années 70 et jusqu’à l’avénement du numérique, « l’art vidéo » ; il est rapidement devenu un rendez-vous incontournable pour les professionnels et les amateurs des cultures électroniques. Cet atelier s’adresse aux étudiant.e.s de DNA3 Art, en poursuivant une réflexion, historique et critique, commencée au semestre 4 : ses objectifs sont,
- Sélectionner, dans le fonds du festival, un ensemble d’œuvres vidéo qui sera intégré au catalogue de la bibliothèque de l’ésam,
- Établir un cahier de charge permettant l’acquisition des œuvres dans le corpus de la bibliothèque
- Réfléchir aux grandes lignes d’ un temps de restitution publique, qui se déroulerai à l’ésam l’année suivant ; exposition, projections, conférences…
Proposer aujourd’hui un tel terrain de travail à un groupe d’étudiant.e.s d’une école d’art, ne va pas sans poser au préalable un ensemble de questions qui permettent de donner des pistes pour la construction d’une méthodologie de travail ;
- Qu’est-ce que la vidéo électronique analogique - enjeux technique de la réflexion ?
- Comment produit-elle des pratiques expérimentales et des formes artistiques - en décalage par rapport à des normes, télévisuelles et spectaculaires, déjà installées dans les années 70 et 80 - enjeux esthétique et politique de la réflexion - ?
- Comment s’est structuré entre 1980 et 2000 un paysage propice à la diffusion de ces pratiques, au niveau international, avec des marqueurs spécifiques locaux et des éléments constants qu’on retrouve partout ? - réflexion sur les contextes techniques, sociaux, économiques et politiques nationaux qui ont permis l’éclosion de “l’art vidéo ».
- Pourquoi s’intéresser à ce vaste continent, qui semblerait, avec notre myopie médiatique en 2024, avoir été enseveli par le numérique ?
Certes, la vidéo électronique analogique n’existe plus aujourd’hui en tant que médium mais, en tant que vaste champ de la culture de l’image en mouvement, elle est, out aussi bien que le cinéma dit « expérimental », le lieu de nombreuses innovations formelles, d'ingénieuses mises au point de dispositifs, des expérimentations sur les supports, des recherches originales sur la perception, qui mettent à l’épreuve aussi bien les limites du visible que celles de l’audible, de la matérialisation de l'image à l’écran et du son dans l’espace et les formes de réception. Ainsi, les incidences fécondes de «l’art vidéo » et du cinéma dit « expérimental » sur l'ensemble des arts visuels tout au long du XXème siècle n’st plus à démontrer : les connaissances en histoire et théorie de ces pratiques audio-visuelles donnent aujourd’hui aux étudiant.e.s des outils d'analyse, complémentaires à ceux d’autres disciplines et sciences humaines, vers l'acquisition d'une distance critique, nécessaire pour la compréhension des images et des sons actuels, hybrides et complexes.
Les récentes approches à la technique proposées par l’archéologie et l’écologie des médias soutiennent notre envie d’arpenter ce terrain sans à priori et pour évaluer un continuum au-delà des clivages de nature techno-idéologique.
Déroulement - atelier en semaine A :
- En 2025 : 26.09 ; 10:10 ; 24.10 ; 19:12 ;
- En 2026 : 16.01.
Références bibliographiques et/ou webographiques :
Fonds documents Vidéo plastique, réserve de l’ésam
Anne Marie Duguet, Vidéo, la mémoire au poing, ed. Hachette, Paris, 1980
Anne Marie Duguet, Déjouer l’image. Créations électroniques et numériques, ed. Jacqueline
Chambon, Paris, 2002
Jean-Paul Fargier, divers textes publiés dans les années 80 et 90.
Nathalie Magnan, Vidéo entre art et communication, Paris, ENSBA, 1997
Nathalie Magnan, Annick Boureaud, Connexions : arts, réseaux, médias, Paris, ENSBA, 2003
D’autres références, bibliographiques et webographiques, seront proposées au long du séminaire
______________________________________________________________________________________________________________________________Méthode d’enseignement :
Une méthodologie qui pose le cadre historique, théorique, critique de l’objet d’étude, le fonds vidéo du festival Video Art Plastique ; temps d’analyse des œuvres du fonds ; choix pour l’archivage et la valorisation des œuvres choisies.
Objectifs du cours :
- Étudier les pratiques électroniques au plan technique, esthétique et conceptuel
- Déterminer les contenus du fonds « Vidéo art plastique » acquis par l’édam
- Comment faire archive ?
- Intégrer ces oeuvres dans le corpus de la bibliothèque, dans une archive spécifique, accessible aux étudiant.e.s et aux chercheurs
- Créer un cahier des charges, mettre en place une méthodologie et des outils selon une codification et des normes en usage
- Valoriser ainsi une autre archive, aujourd’hui invisible dans notre catalogue, acquise il y a vingt ans par l’ésam, via une proposition du Ministère de la Culture et de l’AFAA, le programme « Art en réseau », contenant plusieurs oeuvres des débuts de l’art vidéo nord-américaine entre 1970 et 1980 (Nauman, Viola, Hill, Acconci, Burden, Oursler….)
Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours :
- Connaissances en histoire, critique et théorie des créations électroniques
- Compétences en création d’archive et son accessibilité via la bibliothèque de l’ésam ; comment faire archive ? Comment donner à voir une archive ? Comment penser un événement qui rende lisible une archive ?
Modalités et critères d’évaluation : L’assiduité aux séances, la participation eux échanges.
Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiant·es : Fin décembre.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2. CORPS
________________________ FICHE DE COURS – 2025-2026______________________
Nom et prénom de l’enseignant·e : STEPHENS Phil
Titre du cours : CORPS
Sous-titre du cours : ATELIER AU CHOIX
______________________________________________________________________________________________________________________________Prérequis pour les étudiant·es : Aucun.
Contenu détaillé du cours :
Depuis la préhistoire l'humain éprouve le besoin de créer des images de lui-même pour diverses raisons et à diverses fins.
A travers l'histoire de l'art une pluralité de visions a été développé pour représenter ou évoquer différents aspects du corps, celle-ci continue et continuera à se ramifier à l'époque contemporaine.
Cet atelier se penchera sur les multiples façons d'aborder ce sujet-objet-obsession dans une pratique artistique aujourd'hui, principalement par la création sculpturale mais pas seulement. Autour (avant, pendant, après) de ses créations tridimensionnelles l'étudiant-e devra produire un corpus de travail composé de nombreux éléments en employant au moins deux autres médiums distincts de son choix (dessin, vidéo, photo, peinture, écriture, performance, installation, estampe etc etc...).
Références bibliographiques et/ou webographiques : NR.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Méthode d’enseignement : Présentation en mode magistral, pratique en atelier
Objectifs du cours :
- Commencer ou continuer la sensibilisation à la vaste diversité de matériaux et les gestes associés à leur transformation.
- Développer davantage le sens haptique et l'appréciation du potentiel des matériaux à créer des formes en volume.
- Appréhender la notion de la recherche par l'expérimentation, les rapports possibles entre les médiums et travaux et donc la transdisciplinarité en réalisant un ensemble de travaux avec des matériaux et médiums divers dont la sculpture.
- Aborder les notions de l'accident, l'erreur, l'inattendu, la sérendipité et l'invention.
- Enrichir les connaissances historiques et contemporaines.
- Prendre conscience des différents enjeux possibles d'une pratique plastique.
Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours :
- Certaines connaissances en histoire et évolution de la sculpture jusqu'à sa pratique contemporaine. Certaines connaissances en matériaux et leurs associations : techniques, poétiques, esthétiques etc.
- Certaines connaissances des gestes, pratiques, outils et techniques de transformation des matériaux
- Certaines connaissances des enjeux d'une pratique artistique
Modalités et critères d’évaluation : Évaluation en continu le long de l'atelier, pendant les sessions et sur les travaux finalisé en fin de la période de l'atelier.
Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiant·es : Évaluation en continu le long de l'atelier, pendant les sessions et sur les travaux finalisés en fin de la période de l'atelier.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3. PHOTOGRAPHIE ET PRATIQUES COLLABORATIVES
________________________ FICHE DE COURS – 2025-2026______________________
Nom et prénom de l’enseignant·e : RIFFLET Maxence
Titre du cours : Photographie et pratiques collaboratives
Sous-titre du cours : Bienvenue à la Grâce de Dieu
______________________________________________________________________________________________________________________________Nom de la ou du technicien associé : Jeanne DUBOIS-PACQUET et Michèle GOTTSTEIN
______________________________________________________________________________________________________________________________Prérequis pour les étudiant·es : Une ouverture aux rencontres, une Intérêt pour la photographie, du goût pour l’expérimentation et un brin d’enthousiasme seraient l’idéal !
Contenu détaillé du cours : L’atelier sera délocalisé pour être accueilli dans la salle de quartier de La Grace de Dieu à Caen. Ce quartier prioritaire de la politique de la ville construit dans les années 1960 sera notre territoire de recherche durant l’ensemble de ce cours. Nous commencerons par un arpentage collectif du quartier et nous pousserons les portes des nombreuses structures associatives présentes sur le quartier pour rencontrer certains de leurs animateurs. Nous nous intéresserons autant à l’histoire du quartier qu’à son actualité, aux lieux et à ses habitants. Vous serez ensuite amenés à mettre en place une pratique, seul ou en petit groupe, dans ce contexte. Nous serons particulièrement attentifs aux enjeux relationnels que suppose cette proposition de travail et nous tenterons, collectivement de mettre place des situations de travail qui permettent à des habitants de s’y impliquer.
Si la photographie sera le medium le plus favorisé, d’autres pratiques s’avèrent tout aussi propices aux interactions et seront encouragées : dessin, vidéo, performance etc.
Nous installerons un laboratoire photographique dans la salle de quartier afin de partager cette pratique avec d’autres, et pour montrer vos productions à mesure qu’elles se réalisent. Une exposition du travail sur place est prévue en fin d’atelier.
Références bibliographiques et/ou webographiques :
Yto Barrada, Anaïs Masson, Maxence Rifflet, Fais un fils et jette-le à la mer, sujet-objet, 2004
Fanny Beguery, Adrien Malcor, Enfantillages outillés, L’arachnéen, 2016
Jean-François Chevrier, Entre les beaux-arts et les médias, photographie et art moderne, Paris, éditions l'arachnéen, 2010
Jean-François Chevrier, Œuvre et activité, la question de l’art, Paris, éditions l'arachnéen, 2010.
Jacob Holdt, American pictures, A Personal Journey Through the American Underclass, American pictures foundation, 1985
Làszlò Moholy-Nagy, Peinture, photographie, film, et autres écrits sur la photographie, Paris, Folio essais, Gallimard, 2007
Ugo Mulas, La photographie, le point du jour, 2015
Marc Pataut, « Procédures et formes documentaires, sculpture et langage », Communications, no 71, pp.283-306
Marc Pataut, De proche en proche, Filigranes, 2019
Man Ray, Autoportrait, Arles, Actes sud, 1998
Jorge Ribalta, « Généalogies documentaires. Autour de la photographie ouvrière », Transbordeur Photographie n°4, pp.108-127
Allan Sekula, Écrits sur la photographie, Paris, Beaux-arts de Paris éditions, 2013.
Jeff Wall, Essais et entretiens, Paris, Ensba éditions, 2001
______________________________________________________________________________________________________________________________Méthode d’enseignement : Arpentage du territoire, rencontre avec des habitants, prises de vue photographique, entretiens individuels et collectifs.
Objectifs du cours : Réaliser un travail photographique sur un territoire particulier, en co-création avec des habitants.
Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours : Outre les enjeux propres aux champs de la photographie et de la co-création, des questions d’urbanisme et d’anthropologie seront abordées.
Modalités et critères d’évaluation :
L’évaluation portera sur l’implication personnelle tout au long de l’atelier. Une grande attention sera portée à l’évolution du travail. Rendu en fin de semestre
Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiant·es : 30 janvier 2026.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
4. VOUS ETES ICI
________________________ FICHE DE COURS – 2025-2026______________________
Nom et prénom de l’enseignant·e : GIACALONE Brice, LELIEVRE Nicolas
Titre du cours : Vous êtes ici.
Sous-titre du cours : Situer sa démarche plastique.
______________________________________________________________________________________________________________________________Prérequis pour les étudiant·es : La curiosité.
Contenu détaillé du cours : Il s’agira pour chaque étudiant·e de tenter d’articuler sa démarche personnelle à un lieu donné dans l’espace public. Iels devront donc s’appuyer sur un contexte (spatial, sociologique, politique, urbain…) pour développer des formes in situ, en dehors des espaces habituellement dédiés à montrer des œuvres.
Nous débuterons le travail par l’exploration collective d’un lieu prédéterminé pour tenter de comprendre ce que ça veut dire : le vivre, s’en imprégner, l’arpenter… Les étudiant·es pourront alors créer sur place des formes issues de leurs observation et/ou proposer des principes pour adapter leurs travaux en cours à ce nouveau contexte. Iels pourront également s’appuyer sur un corpus de références qui leur sera donné.
Toutes les formes sont possibles : dessin, peinture, vidéo, photo, sculpture, installation, performance…
Références bibliographiques et/ou webographiques :
- Elena Filipovic, David Hammons. Blizaard Ball Sale, Dilecta Eds, 2022
- Estelle Zhong Mengual, L'art en commun. Réinventer les formes du collectif en contexte démocratique, Dijon : Les Presses du réel, 2018
______________________________________________________________________________________________________________________________Méthode d’enseignement : Méthode d’atelier de création avec des balades urbaines, des repérages, des arpentages.
Objectifs du cours : L’objectif est de travailler in-situ. L’atelier peut aussi bien être l’occasion d’étendre sa démarche à l’espace public que de mettre sa pratique et son questionnement à l’épreuve d’un contexte nouveau et différent.
Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours : Ouverture aux pratiques in situ.
Modalités et critères d’évaluation : Capacité à déplacer sa pratique dans un contexte tout en gardant sa cohérence. Clarté du rendu, qualité des réalisations et de leur articulation avec le réel. C’est cette articulation qui sera particulièrement évaluée.
Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiant·es : NR.
-
1. INITIATION A LA FONDERIE
________________________ FICHE DE COURS – 2025-2026______________________
Nom et prénom de l’enseignant·e : MECHITA Myriam
Titre du cours : Initiation à la fonderie
Sous-titre du cours : NR.
______________________________________________________________________________________________________________________________Nom de la ou du technicien associé : Pedro VICTOR
____________________________________________________________________________________________________________________________Prérequis pour les étudiant·es : Une pratique du dessin et de la sculpture, prérequis d’apprentissage technique à l’atelier métal.
Contenu détaillé du cours :
- Réaliser à l'aide d’un matériau spécifique : la fonte d’aluminium, des projets de sculpture intégrés à un
- Corpus de travaux personnels.
- A partir de la technique de la coulée au sable.
- Des matrices seront apportées pour pouvoir les reproduire en aluminium, après discussion avec
- L’enseignante et les techniciens.
- Sur l'ensemble des expérimentations, deux pièces seront choisies pour être coulées
- Contrainte technique : les étudiants désireux de réaliser des sculptures sur projets devront avoir fait
- Une initiation au préalable, soit au premier semestre, soit lors des premiers jours de l’atelier.
- Une fiche technique sera demandée à l’étudiant.e en amont en vue de préparer l’atelier
- Les prix au kilo pour l’aluminium et le bronze seront fournis par les techniciens accompagnants et le prix de revient de production de la pièce sera communique a la fin de l’atelier.
Références bibliographiques et/ou webographiques : NR.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Méthode d’enseignement : Cours en atelier fonderie et metal par groupe de 5 maximum.
Objectifs du cours : Comprendre la mise en projet, sa mise en œuvre, et le champ spécifique de la fonte d’aluminium et bronze.
Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours : Du croquis, passage à la matrice, puis a la forme exacte, en expérimentant les différents systèmes de coulées. Technique de la fonderie, vocabulaire et gestes inhérents à cette discipline.
Modalités et critères d’évaluation : Élaboration du projet de l’image multiple, réalisation, maitrise de l’image et de sa composition, travail effectue, curiosité, recherches
L’évaluation sera faite la sculpture lors de la fin du façonnage.
Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiant·es : En deux temps, lors de la session de travail sur 2 jours, et fin du façonnage..
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2. LES SCULPTURES PIPELETTES
________________________ FICHE DE COURS – 2025-2026______________________
Nom et prénom de l’enseignant·e : COUTEAU Muriel
Nom de l’intervenant·e : Léo FOURDRINIER.
Titre du cours : Les sculptures pipelettes.
Sous-titre du cours : Quand les mots prennent forme
______________________________________________________________________________________________________________________________Prérequis pour les étudiant·es : Aucun.
Contenu détaillé du cours : Réaliser une création artistique en volume qui soit comme un poème visuel et matériel.
Tous les médiums sont possibles, mais on privilégiera les réalisations en volume comprenant au moins un assemblage et un moulage d’objet. Le texte peut également apparaitre dans sa forme écrite.
Ecriture poétique (Muriel) et composition sculpturale où les objets et les formes incarnent l’expression poétique et textuelle (Léo). Penser l’assemblage et la composition comme des mots et des phrases, penser la sculpture comme un poème.
Références bibliographiques et/ou webographiques :
- Raphael CUIR, hybridation et art contemporain, al Dante, 2013
- Claire GHEERARDYN, « comme on sculpte de l’écriture à la lecture ? réflexion à partir de la poésie des XXe et XXIe siecles » Revue textimage n°18 L’écrit et le sculptural, automne 2024
- Paul-Louis RINUY (dir), La sculpture contemporaine, chap. « Hors limites » PU Vincennes, PUV2016
- Poésie de l’Art Faber « quand les poètes racontent et façonnent les mondes économiques », collectif Actes Sud, Spicilèges de l’art Faber, 2024
- Marilou POTVIN-LAJOIE, La poétique du poème-objet chez André Breton. Mémoire de maîtrise, Université du Québec à Chicoutimi, 2011 : « Le poème-objet est une œuvre composite relevant à la fois de la poésie et de la plastique. Invention d'André Breton, ce mode d'expression artistique méconnu mise sur la combinaison de fragments de poèmes et d'éléments visuels pour stimuler les sens et spéculer sur leur pouvoir d'exaltation réciproque. »
- André Breton
- Alberto Giacometti
- Man Ray
- Robert Rauschenberg
- Theaster Gates
- Bruno Peinado
- Ali Cherri
- Erika Verzutti
- Rachel Harrison
Quelques Poètes :
- Guillaume Apollinaire
- André Breton
- Paul Eluard
- Ito Naga
- Francis Ponge
- Simon Quéhellard
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Méthode d’enseignement :
Phase 1 : atelier d’écriture (3 jours)
Phase 2 : Atelier volume (5jours)
Objectifs du cours : Expérimenter les passages entre les mots et les objets.
Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours : Écriture, assemblage, moulage, sculpture.
Modalités et critères d’évaluation : Engagement créatif dans l’atelier.
Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiant·es : NR.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3. PHOTOGRAMMETRIE
________________________ FICHE DE COURS – 2025-2026______________________
Nom et prénom de l’enseignant·e : BOUDER Christophe.
Titre du cours : Photogrammétrie
Sous-titre du cours : Initiation à l’acquisition de volumes par la photographie.
______________________________________________________________________________________________________________________________Prérequis pour les étudiant·es : Aucun.
Contenu détaillé du cours :
Le module sera l’occasion d’apprendre à numériser des objets ou des espaces par l’intermédiaire de la photographie dans le but de fabriquer des objets manipulables dans un logiciel de 3D.
Ces fichiers numérisés pourront avoir différentes finalités comme apparaître dans une vidéo ou être imprimés.
En fonction de ces différentes finalités, diverses opérations techniques seront nécessaires.
Références bibliographiques et/ou webographiques : NR.
______________________________________________________________________________________________________________________________Méthode d’enseignement : Atelier pratique et démonstrations.
Objectifs du cours : Initiation à la prise de vue d’objets et d’espaces dans le but d’obtenir des fichiers 3D. Initiation aux logiciels de photogrammétrie Reality Capture et Meshroom et Metashape. Coup d’œil sur les applications smartphone.
Initiation au logiciel Blender (libre et gratuit) pour la retouche des fichiers 3D (retopology) en fonction des finalités de ces objets.
Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours : Manipulation de logiciels de photogrammétrie. Manipulation d’un logiciel de création 3D. Approfondissement des notions liées aux images numériques. Méthodologie de projet.
Modalités et critères d’évaluation : Implication, présence et suivi des différentes étapes.
Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiant·es : Pas de rendu.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
4. REMAKE- LE RETOUR
________________________ FICHE DE COURS – 2025-2026______________________
Nom et prénom de l’enseignant·e : PRIM Isabelle
Titre du cours : Remake, le retour
Sous-titre du cours : Réalisation d’un court film à partir d’une scène de Moi, Pierre Rivière ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère de René Allio (1976). Reconstitution d’un décor, interprétation d’un personnage, d’une situation, d’un texte…
______________________________________________________________________________________________________________________________Nom de la ou du technicien associé : Eddy MANERLAX, Camilo BAYTER
______________________________________________________________________________________________________________________________Prérequis pour les étudiant·es : Avoir un intérêt pour le cinéma, l’archive, la littérature.
Contenu détaillé du cours : Découverte et analyse du film de René Aillo : Moi, Pierre Rivière… et analyse de quelques scènes du film. Ce film est l’adaptation d’une archive normande découverte par le philosophe Michel Foucault en 1970. Il s’agit d’un texte autobiographique rédigé par un jeune paysan, accusé d’avoir tué tous les membres de sa famille (sauf son père). Texte écrit en prison. Un récit à la première personne dans lequel il détail ses motivations et sa cavale.
Les premières réflexions sur le film prendront appuie sur d’autres œuvres présentées en inauguration du cours. Puis chaque étudiant-es-s aura à choisir un moment du film dans l’optique de s’en emparer. Il ou elle pourra miser sur le décor et/ou sur l’interprétation d’un personnage et/ou sur un détail quasi imperfectible dans le film, etc. Suite à ce travail d’écriture qui pourra prendre plus d’une forme (croquis, textes, images trouvées en lignes, découvertes du fond René Aillo et Michel Foucault à l’IMEC) se posera la question tu tournage. Artificialité des scènes sur le plateau de tournage et/ou prises de vues en décor naturel, etc. Puis le montage, moment de réécriture et de décision.
Une projection public des films sera à penser ensemble.
Références bibliographiques et/ou webographiques :
Livres :
Michel Foucault : Moi, Pierre Rivière…
Arlette Farge : Le goût de l’archive
Helene Frappat :
Philippe Artières : Le dossier sauvage (et ses autres livres)
Frédéric Boyer : Si Petite
Films :
René Aillo : Les Camisards
Pierre Creton : Paysage imposé
Jacques Meilleurat : Si Petite
Marguerite Duras : Nathalie Granger
Agnès Varda : Sans toit ni loi
Gilles Deroo et Marianne Pistone : La vie des hommes infâmes
Nicolas Philibert : Retour en Normadie
______________________________________________________________________________________________________________________________
Méthode d’enseignement :
- Cours inaugurale avec projection de films et discussions
- Rdv individuels de suivi
- Rdv collectif à mi-parcours
- Tournage sur le plateau de tournage
- Montage en cabine
- Restitution publique
Objectifs du cours : Avec le remake et la « recopie », il s’agira d’apprendre à interpréter plutôt qu’à décalquer, et donc à faire surgir une singularité d’écriture à l’endroit des images, du son et du montage.
Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours :
- Découverte ou familiarisation avec le cinéma contemporain et ses enjeux : dépassement de la séparation entre documentaire et fiction par des formes de récits non conventionnels.
- Maitrise technique des outils du cinémas.
Modalités et critères d’évaluation :
- Cours inaugurale avec projection de films et discussions
- Rdv individuels de suivi (en présence et en distanciel)
- montage
- restitution public
Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiant·es : Début janvier 2026.
-
1. CLUB DE LECTURE(S) ROMANESQUE ET POETIQUE
________________________ FICHE DE COURS – 2025-2026______________________
Nom et prénom de l’enseignant·e : ROLLA Alexandre
Titre du cours : MATIERE(S) A LIRE
Sous-titre du cours : Club de lecture(s) romanesques et poétiques
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Prérequis pour les étudiant·es : NR.
Contenu détaillé du cours : Cet atelier organisé autour de 3 ou 4 séances propose d’aborder la lecture.
Il sera envisagé à la manière d’un club de lecture d’échanger à partir des choix de chacune et chacun des participants d’ouvrages lus ou à lire issus des champs de la littérature et/ou de la poésie qui entrent en résonnance avec le champ des arts plastiques dans les méthodologies de travail de chacune et de chacun.
Les discussions et échanges seront également accompagnés de lectures.
Références bibliographiques et/ou webographiques : La bibliographie sera construite ensemble au fil des séances et constituera à la fin de son élaboration collective le bagage théorique, critique et d’expérimentation de l’ensemble de l’atelier.
Cette dynamique collective et partagée vise à ouvrir et élargir pour chacune et chacun le champ des références pour dynamiser de nouveaux potentiels pour le travail.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Méthode d’enseignement : Après une première séance de discussion à partir de vos propositions de lectures et retour sur des livres déterminants dans la construction de vos travaux artistiques et plastiques, les échanges se prolongeront les deux ou trois séances suivantes avec des discussions autour de ses ouvrages (chacune et chacun apportera les éléments de ses propositions pour discuter avec l’ensemble du groupe).
Objectifs du cours : Faciliter la lecture et aussi la prise de parole, l’écoute, clarifier les enjeux liés aux enjeux de la lecture, aider à dynamiser celle-ci et l’ouvrir à de nouveaux champs
Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours : NR.
Modalités et critères d’évaluation : Présence et participation seront appréciées, participation étant appréciée autant dans l’écoute que la prise de parole.
Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiant·es : Contrôle continu.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2. LECTURE DE L'ART
________________________ FICHE DE COURS – 2025-2026______________________
Nom et prénom de l’enseignant·e : LAGUARDA Alice, ANANTH Deepak
Titre du cours : MATIERE(S) A LIRE
Sous-titre du cours : Lectures de l’art
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Prérequis pour les étudiant·es : NR.
Contenu détaillé du cours : À partir d’une réflexion collective avec Alice Laguarda, il s’agira pour cette séance d’explorer les deux axes suivants :
1 - Découverte et appropriation des ressources
L’importance des librairies (échanges sur les librairies caennaises et parisiennes)
L’importance de l’objet livre
Quelle est votre connaissance et votre fréquentation de ces lieux ?
Quelles relations à la lecture, à la culture, cela peut-il selon vous créer ?
2 - Approche méthodologique et critique de l’acte de lecture (qu’il s’agisse de littérature générale et/ou théorique)
En quoi consiste la pratique de la prise de notes, comment identifier différents modes d’appréhension d’un ouvrage qui pourraient aider à définir une méthodologie de lecture structurée et informée ?
---
Deepak Ananth propose une séance intitulée « Lectures et Arts ».
Lectures des images à travers des textes de tous genres (littérature, histoire de l’art etc).
L’art de l’Ekphrasis, ou les différentes façons de décrire une oeuvre d’art, ses qualités plastiques.
Description et analyse conçues comme un exercice de délectation. Plaisir de l’image indissociable avec le plaisir du texte.
Références bibliographiques et/ou webographiques : A construire tout au long des séances.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Méthode d’enseignement : Atelier reposant sur une exploitation partagée des questionnements collectifs.
Lecture des textes, échanges entre les participants.
Objectifs du cours :
- S’intéresser à la diffusion des livres et à un de leur contexte d’existence dans la cité, la librairie
- Identifier de premiers outils méthodologiques pour une lecture informée et critique
- Incitation à la lecture de la littérature de l’art.
Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours :
- Connaissance des enjeux contemporains liés à l’acte de lecture
- Initiation à une méthodologie de lecture
- Consolidation de la culture générale
Modalités et critères d’évaluation :
- Assiduité
- Participation et échanges
- Présence d’une page dédiée à ses lectures dans le document DNA
Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiant·es : Contrôle continu.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3. DES TEXTES POUR PENSER ET CREER
________________________ FICHE DE COURS – 2025-2026______________________
Nom et prénom de l’enseignant·e : COUTEAU MAUGER Muriel, GIACALONE Brice
Titre du cours : MATIERE(S) A LIRE
Sous-titre du cours : Des textes pour penser et créer
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Prérequis pour les étudiant·es : NR.
Contenu détaillé du cours : Chaque étudiant choisi un texte (article ou ouvrage) en lien avec son champ artistique et l’actualité de la pensée (écologie, art participatif, corps, identité, histoire, politique et société, médias etc.) et prépare pour le groupe une petite synthèse en appuyant sur les idées qui interpellent et qui permettent de faire lien avec sa pratique artistique : comment ce texte peut nourrir un projet, un processus créatif ou une réflexion sur sa pratique : parlons-en !
Cette lecture se fera à partir d’une préparation en amont ou par la technique de l’arpentage. Tout cela sera précisé avant les séances.
Références bibliographiques et/ou webographiques :
Absolument non exhaustif et bien arbitraire :
Amelia Jones, Voir autrement. Histoire et théorie de l’identification et des arts visuels
Vandana Shiva, la sagesse de la terre
Donna Haraway, manifeste ciborg et autres essais
Françoise Vergès, Programme de désordre absolu
Jacques Ranciére, Le partage du sensible
Hal Foster, Le retour du réel
Edouard Louis, En finir avec Eddy Bellegeule
David Graeber, Au commencement était… Une nouvelle histoire de l'humanité
Didier Eribon, Retour à Reims
Annie Ernaux, Les années
Aldo Leopold, Almanach d’un comté des sables
Elisée Reclus, Histoire d’un ruisseau
Italo Calvino, Les Villes Invisibles
Vinciane Desprez, les morts à l’œuvre
Baptiste Morizot, en attendant les vautours
Baptiste Morizot et Suzanne Husky, Rendre l’eau à la terre
Stuart Hall, Identités et cultures. Politiques des Cultural Studies
Tim Ingold, Marcher avec les dragons
Estelle Zhong-Mengual, L'art en commun. Réinventer les formes du collectif en contexte démocratique
Emmanuel Zwenger, l’art de vivre…
Les étudiants et étudiantes sont invité·es à faire des propositions de lectures.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Méthode d’enseignement : Atelier collectif/partage de lectures
Objectifs du cours :
- relier théorie et pratique artistique personnelle
- comprendre les enjeux contemporains qui animent la création artistique
- favoriser la discussion critique et l’échange
Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours : Réflexion critique, connaissances des enjeux contemporains et des contextes interdisciplinairesAnalyser, écouter, partager, dialoguer.
Modalités et critères d’évaluation : Qualité de la participation. Capacité à faire le lien entre les textes, les enjeux artistiques et sa pratique pour développer une pensée critique.
Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiant·es : Contrôle continu.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
4. PRATIQUE DE LA LECTURE
________________________ FICHE DE COURS – 2025-2026______________________
Nom et prénom de l’enseignant·e : CARGIOLI Simonetta
Titre du cours : MATIERE(S) A LIRE
Sous-titre du cours : Pratiques de la lecture
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Prérequis pour les étudiant·es : NR.
Contenu détaillé du cours : Qu’est ce qu’est lire ? Une question simple, pourtant… Cette question est le départ de notre atelier ; elle n’attend pas une réponse, elle ouvrira plutôt la réflexion aux pratiques et aux usages singuliers, aux expériences individuelles de cet acte, jamais banal, de la lecture.
Nous partirons donc de ces expériences personnelles ; lors de la première séance, nous amènerons toutes et tous en classe les matériaux qui font aujourd’hui de nous des lectrices et des lecteurs. Des lectures marquantes ; des lectures difficiles ; des rencontres lumineuses ou fondamentales ; des coups de coeur ; des coups de gueule ; les lectures actuelles, ou celles sur lesquelles nous revenons souvent… Ce sera une séance faite des tissages horizontaux entre les participant·es.
Ensuite, nous pourrons travailler ensemble à partir d’actions précises, par exemple ; trier, prendre des notes, archives, mémoriser, mettre en relation, tisser des liens, archiver… Et interroger aussi, à partir aussi bien de nos bibliothèques que de la bibliothèque de notre école, les formes et les statuts éditoriaux des « objets à lire » que nous aimons tant fréquenter. Nous nous poserons des questions sur les liens entre nos lectures et nos recherches plastiques ; quand et pourquoi parle-t-on de référence ? …
Comment peut-on puiser dans les lectures pour construire notre propre vocabulaire et pour y trouver aussi le moyen de renforcer, soutenir, affirmer le travail plastique ?
Enfin, mais surtout, notre atelier sera un moment de plaisir et de partage autour de la « lecture ».
Références bibliographiques et/ou webographiques : A construire tout au long des séances. Nous aurons aussi des « visites » à la bibliothèque, correspondant à des besoins et à des critères repérés en commun.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Méthode d’enseignement : Atelier ; production, partage et circulation des savoirs privilégiant l’horizontalité, sous la direction du professeur. Méthode collective ; partage, lecture à voix haute, échanges….
Objectifs du cours :
- Apprendre à proposer des ressources textuelles, les situer dans sa propre expérience de lectrice-lecteur ; trouver les mots pour transmettre cette expérience.
- Mettre en relation les ressources textuelles avec les recherches plastiques
- Construire son propre parcours et paysage des lectures
- Penser l’acte de la prise de note : ou comment on s’approprie une ressource textuelle
- Lire, c’est manger ; méditer, c’est assimiler... : ou ce qui reste d’une ressource textuelle
- Pourquoi une lecture est difficile ? Les écueils, la fatigue, la lecture dont on ne voit pas le bout, le découragement…
- Conseils pour boîtes à outils ; rédiger une fiche de lecture, prendre des notes, savoir maîtriser les citations….
Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours :
- Acquérir une plus forte conscience de l’acte de lecture
- Construire les formes personnelles d’un dialogue avec les ressources textuelles
- Acquérir concrètement les techniques et la méthodologie pour créer des liens avec les ressources textuelles, et entre celles-ci et les recherches plastiques.
- Comprendre, analyser, avoir un regard critique sur une ressource textuelle
- Apprendre à utiliser les ressources de la bibliothèque
- Arpenter d’un regard critique les formes des ressources textuelles entre le support écrit et le support numérique
Modalités et critères d’évaluation : Assiduité aux 3 séances, participation et investissement ; présence d’une page dédiée à ses lectures dans le document DNA.
Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiant·es : Contrôle continu.
-
1. PARLONS PARLONS... (A. ROLLA)
________________________ FICHE DE COURS – 2025-2026______________________
Nom et prénom de l’enseignant·e : ROLLA Alexandre
Titre du cours : Parlons Parlons…
Sous-titre du cours : Atelier de méthodologie de prise de parole pour la présentation de son travail
Prérequis pour les étudiant·es : Choisir et s’inscrire dans cet atelier (concerne la moitié de la promotion des DNA3 art qui doivent choisir entre ce cours et celui proposé en miroir par Simonetta Cargioli).
Contenu détaillé du cours :
Cet atelier organisé autour de 3 ou4 séances propose d’aborder la parole, un élément fondamental dans la perspective et les exigences du diplôme à venir.Considérer la parole, c’est envisager plus globalement la notion d’adresse et par là-même, considérer la réception de cette parole, l’écoute.
Seront évoquées un ensemble de déclinaisons, notions, de la causerie à l’éloquence, du bavardage à la rhétorique, comprise dans les 3 composantes de sa substance : enseigner, persuader et émouvoir.
Références bibliographiques et/ou webographiques :
Philip Roth, Parlons travail, Paris, Folio, 2006
Annie Ernaux, L’atelier noir, Paris, Gallimard, L’imaginaire, 2022
Edouard Levé, Autoportrait, Paris, POL, poche,A compléter ensemble en fonction de vos travaux, aspirations et de vos propres références
Méthode d’enseignement :
Après une première séance de discussion à partir de vos appréhensions, appréciations et retour de vos expériences lors des évaluations et de votre compréhension des attentes et des attendus pour le passage du diplôme, les échanges se prolongeront les deux ou trois séances suivantes avec des discussions autour de vos travaux (chacune et chacun apportera un élément de son travail pour discuter avec l’ensemble du groupe)Objectifs du cours : Faciliter la prise de parole, l’écoute, clarifier les enjeux liés à cette prise de parole, aider à préparer une présentation et éviter les pièges de la justification
Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours : voir précédent.
Modalités et critères d’évaluation : Présence et participation seront appréciées, participation étant appréciée autant dans l’écoute que la prise de parole.
Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiant·es : pas de rendu, présence durant l’ensemble des séances du cours.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2. METTRE DES MOTS (S. CARGIOLI)
________________________ FICHE DE COURS – 2025-2026______________________
Nom et prénom de l’enseignant·e : CARGIOLI Simonetta
Intitulé du cours : METTRE DES MOTS
Sous-titre du cours : Travaux dirigés d’initiation à la recherche
Prérequis : NR
Objectifs du cours : Accompagner les étudiant.e.s dans l’élaboration et construction d’une prise de parole dont la forme n’est pas fixée à priori (exposé , conférence illustrée, performance de lecture, travail audio-visuel ou sonore....) permettant
- de « mettre des mots » sur les expériences plastiques, afin de savoir se présenter et présenter son travail de recherche et ses production au diplôme
ainsi que
- l’appropriation d’un vocabulaire juste, précis et singulier, cohérent avec les enjeux du travail - la consolidation d’une distance critique et une capacité d’analyseContenu : Mettre des mots sur ses recherches et son travail, pour savoir se présenter et présenter son oeuvre.
Méthode d’enseignement :
Des Travaux Dirigés vers un exposé oral final en solo ou à plusieurs, à partir d’une référence textuelle (essai, article, ouvrage littéraire et poétique, catalogue d’exposition ….) : le but de l’exercice est emmener l’étudiant.e à inscrire ses intentions de recherche et son travail dans un paysage de références, tisser un réseau des relations réfléchies et argumentées avec des notions, des idées, des manières de penser et des formes d’ énonciation
et maitriser la présentation orale critique au moment du diplôme.Modalités et critères d’évaluation : Une prise de parole appuyée sur une trace écrite.
Références bibliographiques : Les références bibliographiques seront proposées au long des Travaux Dirigés.
-
EN ATTENTE DE CONTENU