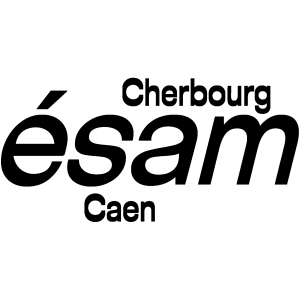[CDC M1-ART-25-26] Projet plastique
Section outline
-
Projet camouflage avec Pierre TATU
________________________ FICHE DE COURS – 2025-2026______________________
Nom et prénom de l’enseignant·e : Pierre TATU
Titre du cours : Projet camouflage
Sous-titre du cours : Revisiter l'idée d'exposition en s'inspirant du concept de camouflage
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Prérequis pour les étudiant·es : NR.
Contenu détaillé du cours : En s'inspirant du concept de camouflage et des multiples approches que celui-ci permet, les étudiants auront à faire des propositions qui intègrent ces objectifs, dans le but de produire une exposition collective où le travail de chacun s'imbriquera dans un ensemble composite fait de contenus et de contenants, d'objets autonomes (et de "supports") aux fonctions variables et variées, fait aussi de jeux avec la matérialité (et la virtualité) de l'espace d'exposition.
Les étudiants auront à interroger leur pratique personnelle en regard des questions soulevées par cet atelier, en même temps qu'ils auront à se confronter à celle de leurs camarades et à y collaborer dans une forme de proximité voire de complicité.
Références bibliographiques et/ou webographiques :
· Hanna Rose Shell - "Ni vu, ni connu - Le camouflage au regard de l'objectif " - éd. Zones Sensibles, 2014 (disponible à la bibliothèque)
· Jean Baudrillard - "Simulacres et simulation" - éd. Galilée, Paris, 1981.
· Georges Didi-Huberman, "Phasmes", Collection « Paradoxe », Editions de Minuit, Paris 1998
· Anne Sauvageot, "Sophie Calle. Lʼart caméléon", Paris, PUF, 2007. - Marie Lechner - "Le nouvel âge du camouflage" - Libération 04/07/14 http://next.liberation.fr/culture-next/2014/07/04/le-nouvel-age-du-camouflage_1057464/
· Nathalie Desmet, "Une relation esthétique impossible : les expositions dans lesquelles il nʼy a rien à voir", in Nouvelle revue d'esthétique n°3 / Paris, PUF, 2009. http://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-d-esthetique-2009-1-page-85.htm
· Nathalie Desmet, "LʼArt de faire le vide. Lʼexposition comme dispositif de disparition de lʼoeuvre", in Nouvelle revue d'esthétique n°8 / Paris, PUF, 2011. https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-d-esthetique-2011-2-page-40.htm/
· Monty Python - "How not to be seen" - 11ème épisode de la deuxième série de Monty Python's Flying Circus, 1970 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Méthode d’enseignement : Recherches et expérimentations individuelles et collectives, entretiens individuels et collectifs, accrochage de groupe.
Objectifs du cours : Depuis les années 90, de nombreux artistes se sont approprié le rôle de scénographe voire de décorateur marquant ainsi leur volonté de rupture avec l'idée d'autonomie de l'oeuvre d'art et s'inscrivant, dans le même temps, dans une tradition de l’exposition conçue comme un projet global, présentant des oeuvres mais aussi des objets, du mobilier, de l’architecture ...
Partant du constat des nouvelles relations que cela a introduit entre le spectateur, l’oeuvre et l’espace où elle est présentée, cet atelier propose de re-visiter l'idée d'exposition, comme lieu de production – à la fois - d'objets autonomes et d'objets plus indexés, destinés par exemple à en être le réceptacle, ou pouvant prendre la place des éléments de ce dispositif complexe et complet qu’est l’exposition.
Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours : Préciser sa réflexion. Positionnement critique. Sens du collectif.
Modalités et critères d’évaluation : Investissement personnel, qualité et pertinence de la réflexion et des recherches, qualité des propositions plastiques et de l'engagement collectif.
Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiant·es : 14/11/2025.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Frammenti avec Lina HENTGEN
________________________ FICHE DE COURS – 2025-2026______________________
Nom et prénom de l’enseignant·e : Lina HENTGEN
Titre du cours : Frammenti
Sous-titre du cours : NR.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Prérequis pour les étudiant·es : NR.
Contenu détaillé du cours : Nous allons travailler à partir d'oeuvres issues des collections des institutions locales (FRAC, Musée des beaux arts...). Il faudra mener des recherches pour comprendre la génèse des oeuvres choisies, les artistes qui les ont crées et dans quel contexte historique, politique etc. Ensuite nous travaillerons à partir de fragments des oeuvres choisies pour réaliser un ensemble d'oeuvres. Il faudra déterminer comment travailler à partir d'une citation, d'un fragment d'une oeuvre. Quelles seront les opérations plastiques choisies pour definir cette recherche ? Comment à partir de sa propre pratique on peut intégrer le fragment d'une altérité ? Comment à partir d'un morceau, former un tout ?
Autant de questions qui permettront de lier histoire de l'art, pratique d'atelier, recherches et modalités des formes exposées.
Références bibliographiques et/ou webographiques : NR.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Méthode d’enseignement : Séances de « crits ». Présenter le travail de recherches et de création réalisé en dehors des séances du studio.
Objectifs du cours : Ce studio articule pratique d'atelier et méthodes de travail et des recherches en collaboration avec les institutions locales. Travail individuel et collectif pour la restitution sous forme d'exposition en fin de semestre.
Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours : Recherches et création à partir d’une collection. Travail individuel mis au service du collectif.
Modalités et critères d’évaluation : Contrôle continu, plusieurs rendus et prise de parole individuelle et collective souhaitée.
Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiant·es : Rendu sous forme d’exposition en fin de semestre.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Studio Modulaire avec D. DRONET, C. BOUDER, N. GERMAIN & A. RICCI
________________________ FICHE DE COURS – 2025-2026______________________
Nom et prénom de l’enseignant·e : David DRONET, Christophe BOUDER, Nicolas GERMAIN & Alice RICCI
Titre du cours : Studio Modulaire
Sous-titre du cours : Création en environnement numérique.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Prérequis pour les étudiant·es : L’étudiant·e s’engage pour les deux semestres
Contenu détaillé du cours : Le studio modulaire fait partie du pôle Image, Son & Numérique, pôle dédié à la production d’oeuvres audiovisuelles et/ou aux pratiques liées aux nouveaux outils numériques.
Le Studio Modulaire repose sur l’exploration créative des techniques/technologies numériques, sonores et électroniques. De par la nature même des outils, leur complexité de mise en oeuvre et les multiples compétences requises, le travail en équipe s’impose comme une nécessité. Cependant, durant l’année, les étudiant·es définissent un projet de création personnelle. Le développement de ces projets s’appuie sur un ensemble de modules techniques proposés par l’équipe encadrante du Studio Modulaire (son, code informatique, 3D, électronique…). Les étudiant·es participent donc collectivement aux sessions leur permettant de gagner en autonomie de travail et d’assumer la réalisation de leur projet, avec le soutien des enseignant·es, du technicien référent de l’atelier et la collaboration de la technicienne de l’atelier son.
Pour les DNA3 et les M1
· 2 modules techniques (voir annexe)
· Module pro & Culture Club, suivi de projets
· projet personnel
· Tutorat DNA2
· Workhop Caen/La Haye/Reykjavik (8 places)
Références bibliographiques et/ou webographiques :
Pour comprendre les médias, Marshall Mc Luhan (Points-Essais, Paris, 1968)
Déjouer l’image (Créations électroniques et numériques), Anne-Marie Duguet (Éditions Jacqueline Chambon, Nîmes, 2002)
L’art numérique, Edmond Couchot et Norbert Hillaire (Champs/Flammarion, Paris, 2003)
Code de création, John Maeda (Thames & Hudson, Paris, 2004)
Nouveaux médias, nouveaux langages, nouvelles écritures, Ouvrage collectif, coordonné _par Colette Tron (L’entretemps, Paris, 2005)
L’art a-t-il besoin du numérique ? (Colloque de Cerisy), Jean-Pierre Balpe & Manuela de Barros (Hermès, Paris, 2006)
L’art numérique, Christiane Paul (Thames & Hudson, Paris, 2004)
L’art Internet, Rachel Greene (Thames & Hudson, Paris, 2005)
Les nouveaux médias dans l’art, Michael Rush (Thames & Hudson, Paris, 2005)
Lichtkunst aus Kunstlicht / Light Art from Artificial Light, Peter Weibel and Gregor Jansen (ZKM, 2006)
Art des nouveaux médias, Mark Tribe & Reena Jana (Taschen, Köln, 2006)
Arts et nouvelles technologies - art vidéo, art numérique, Florence De Mérédieu (Editions Larousse, 2011)
A Touch of Code: Interactive Installations and Experiences, (Gestalten, 2011)
Art et numérique en résonance, Dominique Moulon (Co-édition Maison populaire et Nouvelles Éditions Scala, 2015)
Le mirage numérique — Pour une politique du big data, Evgeny Morozov (Éditions Amsterdam, collection Les prairies ordinaires, 2015)
A quoi rêvent les algorithmes : Nos vies à l’heure des big data, Dominique Cardon (Seuil, 2015)
Open Codes. Leben in digitalen Welten, Peter Weibel (ZKM, 2017)
Coder le monde - Mutations/Créations, (Editions Hyx, 2018)
L’art au-delà du digital, Dominique Moulon (Nouvelles éditions Scala, 2018)
Culture numérique, Dominique Cardon (SciencesPo, Les presses, 2019)
Sound Art, Sound as a medium of art, Peter Weibel(ZKM, 2019)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Méthode d’enseignement :
· Le premier semestre privilégie les apprentissages techniques (modules techniques) et la mise en forme d’un dossier d’intention.
· Le second semestre permet le développement, le suivi et la réalisation de projets personnels et/ou collectifs
· Toute l’année les étudiants rencontreront régulièrement des artistes et des professionnels des champs concernés.
Objectifs du cours : Le Studio Modulaire est à la fois un lieu physique et un proposition pédagogique fondée sur l’hybridation des connaissances (une culture numérique, des connaissances techniques des langages et logiciels pour la création artistique, une capacité critique de l’utilisation des nouvelles technologies), une méthodologie de travail qui permet l’articulation entre le soft (langages, logiciels) et les procédés de fabrication (impression 3D, hardware, etc.) et qui privilégie des contacts avec le milieu professionnel, l’environnement et l’actualité culturelle.
Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours :
· Initiation interactivité et visite virtuelle
· Initiation électronique - Initiation 3DS MAX
· Initiation Code créatif
· Conceptualisation et développement d’un projet personnel
· Réalisation de dossiers artistiques
Modalités et critères d’évaluation :
· Méthodologie dans la mise en oeuvre du projet
· Qualité conceptuelle, plastique et technique du projet final
· Implication dans l’implication collective de l’atelier
Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiant·es : Fin décembre + Mai 2026
Annexes Studio Modulaire :
MODULES TECHNIQUES OPTIONNELS
Module Électronique (Alexis Choplain) L’objectif de ce module est de se familiariser avec l’environnement technologique analogique à l’origine des pratiques numériques. Il s’agira de manipuler les différents outils nécessaires à la conception et à la fabrication de circuits électroniques avec des composants physiques (résistances, diodes, condensateurs, transistors, etc…) et d’acquérir les bases nécessaires au contrôle de moteurs, de la lumière et d’information sous forme de signal électrique. En lien avec le Studio son, les étudiants prototyperont et usineront collectivement un synthétiseur modulaire.
3D (Christophe Bouder),
· Découverte de l'interface et des actions simples sur les objets
· Manipuler les outils de modélisation de base (polygonale)
· Texturer un objet Mettre en lumière Mettre en scène FreeCad
· Dessiner des plans Associer des cotes
· Modéliser un volume Sortir des plans cotés
· Meshroom Photographier un objet ou une scène Générer un nuage de points Créer un maillage 3D Faire de la retopology
Module Max MSP Happy Patching (Nicolas germain) Max est un logiciel de programmation graphique qui permet de traiter, de générer et d'interagir avec des données MIDI, des flux audio, vidéo, et tout autre type de données, comme celles provenant de capteurs.
· Découverte et initiation
· Communication
· MIDI Synthèse et traitement audio
· Manipulation vidéo Interactions
Module Code Créatif (Arnaud Gabard) Ce module propose une approche du langage informatique permettant la réalisation de systèmes et de montages constitués de capteurs (présence, son, lumière…), de composants programmables (Arduino, Raspberry Pi…) et d’actionneurs (moteurs, lumières, lecteurs de sons et images…) permettant le contrôle, le pilotage ou l’automatisation d’animations ou d’interactions intégrés à des dispositifs plastiques.
MODULES OBLIGATOIRES
Module Pro (David Dronet) Suivi de projets, veille, actualités et initiation au montage de dossiers, budgets… Association de chaque étudiant à un artiste de la programmation d’]interstice[ dès octobre (suivi, assistanat…)
Culture Club (David Dronet) Rencontres avec des artistes en résidence à Caen (matinée présentation et table rondes, après-midi entretiens personnels)
-
________________________ FICHE DE COURS – 2025-2026______________________
Nom et prénom de l’enseignant·e : Équipe pédagogique
Titre du cours : Mise en espace
Sous-titre du cours : Échanges collectifs autour de travaux présentés dans un espace de l'école.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Prérequis pour les étudiant·es : NR.
Contenu détaillé du cours : Le déroulé de ces journées est proposé par les enseignant.e.s qui les conduisent. Il peut également être initié par les étudiant.e.s elles.eux-même.
Le principe est de confronter l'exposition des travaux aux regards et aux avis de chacun.e.
Références bibliographiques et/ou webographiques : NR.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Méthode d’enseignement : Accrochages collectifs et discussions.
Objectifs du cours : Évaluer la pertinence des diverses propositions d'accrochage à travers un regard critique et collectif.
Connaissances et/ou compétences transmises grâce à ce cours : Autonomie dans les choix de présentation des travaux.
Modalités et critères d’évaluation : Participation et engagement individuels et collectifs.
Dates ou période pressentie des rendus pour les étudiant·es : NR.
-
________________________ FICHE DE COURS – 2024-2025______________________
Mobilité – crédits érasmus
Rapport de stage
Le rapport de stage fera entre 20 et 30 pages maximum (visuels inclus) et comprendra :
1- Une présentation du lieu de stage (contexte du pays, scène artistique, structure d’accueil...) et des missions confiées ;2- Une analyse critique du stage, incluant entre autres une présentation de l’articulation du stage avec les projets personnel, artistique, professionnel ;
3- Des préconisations : apports et limites du stage.
+ Bibliographie (facultative)
Si une autre forme de rendu est choisie (podcast, film, édition...), celle-ci devra être accompagnée d'un court rapport textuel renseignant les 3 points listés ci-dessus.
L’évaluation des crédits dédiés se fera sur une double lecture (enseignant·e tuteur/tutrice + un·e autre enseignant·e de l’ésam) + avis consultatif du·de la maître de stage.